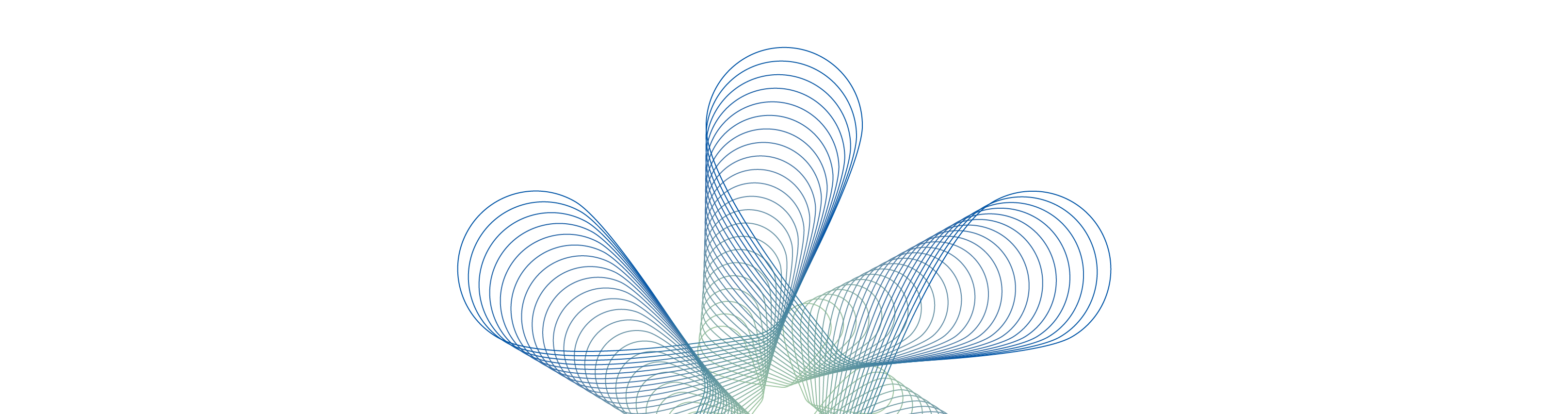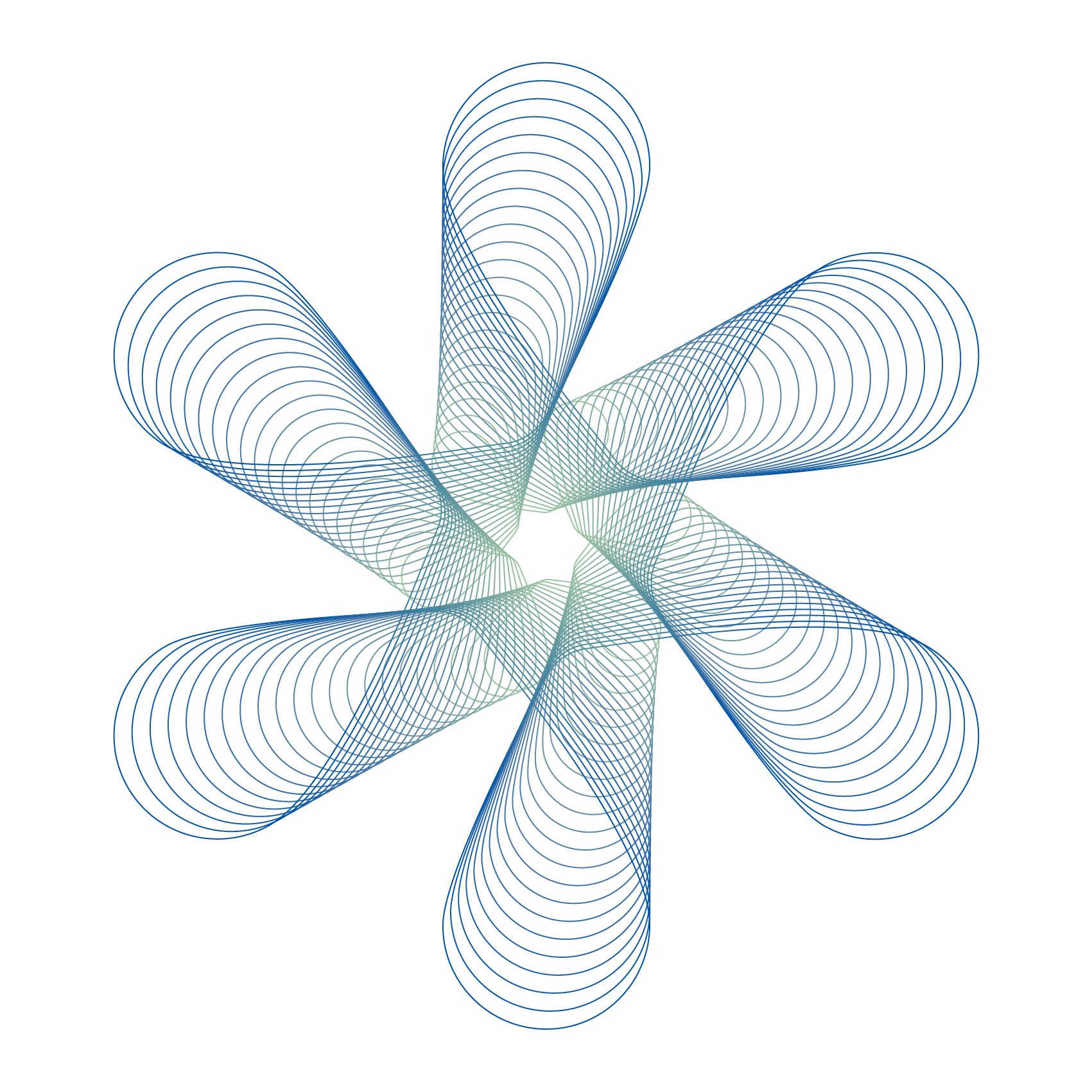CONFORMITÉ AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES ET GESTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES
En vertu de son statut intergouvernemental, le CERN établit lui-même le cadre règlementaire nécessaire à son fonctionnement, y compris en ce qui concerne la sécurité. Ce cadre englobe l’ensemble des activités et des sites et tient compte de la réglementation des États hôtes et de l’UE, ainsi que des normes internationales. Le Laboratoire s’engage à limiter son impact sur l’environnement et déploie un vaste éventail de mesures pour y parvenir, notamment une surveillance environnementale.
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX CONVENTIONNELS
La Politique de Sécurité du CERN recouvre tous les aspects de la sécurité (santé et sécurité au travail, radioprotection, protection de l’environnement et sûreté – y compris radiologique – des installations). Les départements sont chargés de mettre en place des mesures de prévention des accidents et événements environnementaux et des accidents évités de justesse, ainsi que des mesures correctives. Le suivi de ces mesures est supervisé par le Comité directeur pour la protection de l’environnement (CEPS – voir Approche managériale).
Afin de limiter le plus possible l’impact des activités du CERN sur l’environnement, l’unité Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement (HSE) mène un vaste programme de surveillance environnementale fondé sur des paramètres radiologiques et physicochimiques. En cas d’anomalie ou de libération accidentelle de substances chimiques, des procédures spécifiques d’intervention rapide sont prévues pour éviter ou limiter l’impact sur l’environnement.
Le CERN a défini un cadre de classification des événements en fonction de leur impact potentiel, et mis en place une solide procédure de communication et de suivi avec les autorités locales.
Pendant la période concernée par ce rapport, une fuite d’eau a été signalée et résolue (voir Eau et effluents), mais aucun événement passible de sanction, financière ou autre, ne s’est produit.
PRÉVENTION DES ACCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX D’ORDRE RADIOLOGIQUE
Des règles strictes ont été instaurées en matière de radioprotection et de sûreté radiologique (voir Rayonnements ionisants). Aucun accident environnemental d’ordre radiologique ne s’est jamais produit sur le domaine du CERN.
GESTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES
Le cadre réglementaire du CERN pour les substances dangereuses traite des risques potentiels pour le sol et l’eau, et évolue en fonction des réglementations applicables des États hôtes. Les substances dangereuses font l’objet d’une surveillance et de rapports réguliers. Le Registre des produits chimiques du CERN pour l’environnement, la santé et la sécurité (CERES) est un outil en ligne permettant de tracer les produits chimiques et de déterminer les risques associés et leur emplacement. Il est ainsi possible d’adapter les mesures préventives en place pour atténuer les risques et d’élaborer des mesures opérationnelles pour gérer les incidents potentiels.
Cet outil, actualisé en permanence par les utilisateurs, dispose d’un système intégré permettant de vérifier les informations saisies. Selon la quantité et le type de produit, une analyse du risque environnemental tenant compte d’un ensemble de critères et des spécificités de l’infrastructure du CERN peut s’avérer nécessaire. L’outil aide également à repérer les bâtiments où se déroulent des activités utilisant des substances dangereuses qui impliquent des contraintes techniques liées à la quantité, à la toxicité et au type de substance, et nécessitent l’établissement de priorités et de plans d’action. Fin 2024, plus de 3 000 entrées validées figuraient dans ce registre, dont 1 400 vérifiées par des utilisateurs, et plus de 850 faisaient l’objet d’une analyse des risques environnementaux.
La réduction du volume d’huiles minérales présent dans les transformateurs du CERN fait partie des priorités. Un projet de remplacement des transformateurs à huile par des alternatives sans huile a été lancé en 2021. Plus de 100 transformateurs devraient ainsi être remplacés sur une période de dix ans. Au cours de la période concernée par ce rapport et jusqu’en mars 2025, plus de 25 unités auront été remplacées et 20 autres supprimées, ce qui représente quelque 100 m3 (environ 80 tonnes) d’huiles minérales en moins.
Le nettoyage des fosses de rétention des transformateurs, qui sont remplies de galets présentant différents degrés de concentration en huile, est également prévu. En 2024, le CERN a mené une analyse de durabilité portant sur des aspects techniques, logistiques, économiques, opérationnels et environnementaux afin de déterminer la solution la plus efficace pour traiter et récupérer ces galets, conformément aux directives européennes et locales. Différentes options ont été testées, dont le nettoyage et le stockage sur place, ce qui a permis de renforcer le rôle du CERN en tant que banc d’essai pour l’optimisation des pratiques de recyclage et de gestion des déchets. Après avoir évalué l’impact environnemental et les contraintes du site, il a été établi que l’option la plus efficace consisterait à acheminer les galets vers une entreprise locale de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage. Cette solution permettrait la réutilisation de ce matériau pour la production de ciment ou le revêtement routier, par exemple.
Les matières radioactives sont une catégorie spécifique de substances dangereuses strictement réglementées tout au long de leur cycle de vie, notamment en ce qui concerne leur utilisation, leur manipulation et leur transport. Des évaluations des risques radiologiques sont menées avant toute manipulation, et les utilisateurs suivent un programme complet de formation à la radioprotection pour être capables d’évaluer les risques radiologiques et d’appliquer les règles et procédures de radioprotection correspondantes. Le transport de ces matières sur le domaine du CERN et à l’extérieur est étroitement surveillé et, sur la voie publique, il doit se conformer à la réglementation de l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route).
OBJECTIFS POUR 2030
L’objectif du CERN est de réduire l’impact potentiel sur l’environnement des substances dangereuses utilisées dans le cadre de ses activités. Concrètement, il s’agit de réduire de 120 m3 le volume d’huile de transformateur présente sur le domaine (année de référence : 2023, 1 784 m3).
POUR ALLER PLUS LOIN
Sabrina Schadegg dirige la section Prévention environnementale du groupe Environnement. Elle est membre du projet HOR (HSE Operational Response), lancé en 2022 par l’unité Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement (HSE) pour clarifier et ajuster les capacités d’intervention opérationnelle de tous les services de l’unité HSE.
— De quelle manière le projet HOR a-t-il contribué à renforcer la collaboration entre équipes, notamment avec le Service de Secours et du Feu ?
SS : L’un des six lots de travaux du projet consiste à déterminer la réponse adaptée aux situations d’urgence touchant l’environnement et les biens du CERN, afin de pérenniser la capacité du Laboratoire à protéger l’environnement en cas d’événement environnemental notable de type déversement de produit chimique, incendie ou tout autre incident environnemental imprévu.
Grâce au groupe de travail PoLiChem (Prevention of Pollution by Liquid Chemical Agents) – qui, entre 2015 et 2018, a recommandé, sous la surveillance du CEPS, des actions pour réduire les risques de pollution – et au déploiement de l’outil CERES, le CERN a amélioré notablement son approche de la prévention des incidents environnementaux. Certaines des installations sont assez anciennes et des incidents environnementaux de faible ampleur peuvent se produire lorsque des mesures de rétention collectives, comme des bassins de rétention centralisés en amont des points d’émergence des rivières, n’ont pas été systématiquement intégrées à la conception d’origine. Le Service de Secours et du Feu du CERN (CFRS) est dûment équipé et formé pour intervenir de manière autonome en cas d’événement environnemental, notamment si une alarme est déclenchée par les stations de surveillance environnementale, d’où l’importance de mettre à jour le protocole d’intervention existant. Le Service de Secours et du Feu du CERN (CFRS) est dûment équipé et formé pour intervenir de manière autonome en cas d’événement environnemental, notamment si une alarme est déclenchée par les stations de surveillance environnementale, d’où l’importance de mettre à jour le protocole d’intervention existant.
— Quelles ont été les principales difficultés liées à la mise à jour du protocole d’intervention, et comment a-t-il été testé ?
SS : Le principal défi a été d’élaborer une procédure qui soit à la fois complète et facile à suivre. Elle devait couvrir le plus d’incidents prévisibles possible (idéalement jusqu’à 90 %), tout en permettant une certaine flexibilité en cas d’imprévu. Le nouveau protocole a été élaboré sur deux ans et testé lors d’un exercice à grande échelle à l’été 2024. Cet exercice a mis en lumière les points forts de la procédure et les aspects à améliorer. Point important : il a favorisé un rapprochement entre le CFRS, l’équipe Environnement, les opérateurs du Centre de contrôle du CERN – qui supervise l’infrastructure technique – et les collègues responsables de l’équipement. Ce protocole sert de point de référence pour les systèmes de réponse opérationnelle intégrés à utiliser en cas d’événements environnementaux.